Principaux financeurs


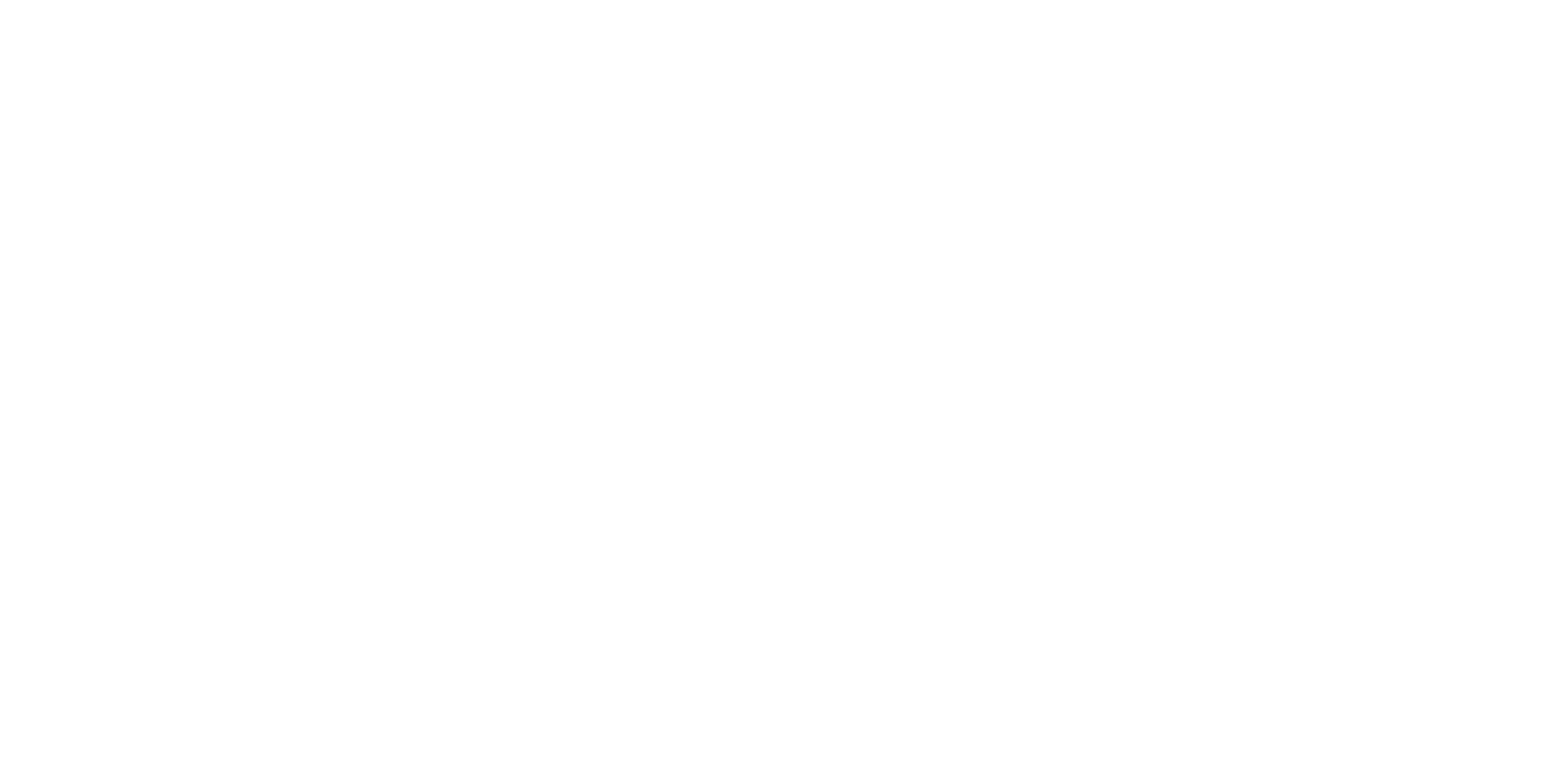
© 2024 Espèces Exotiques Envahissantes Hauts-de-France.


